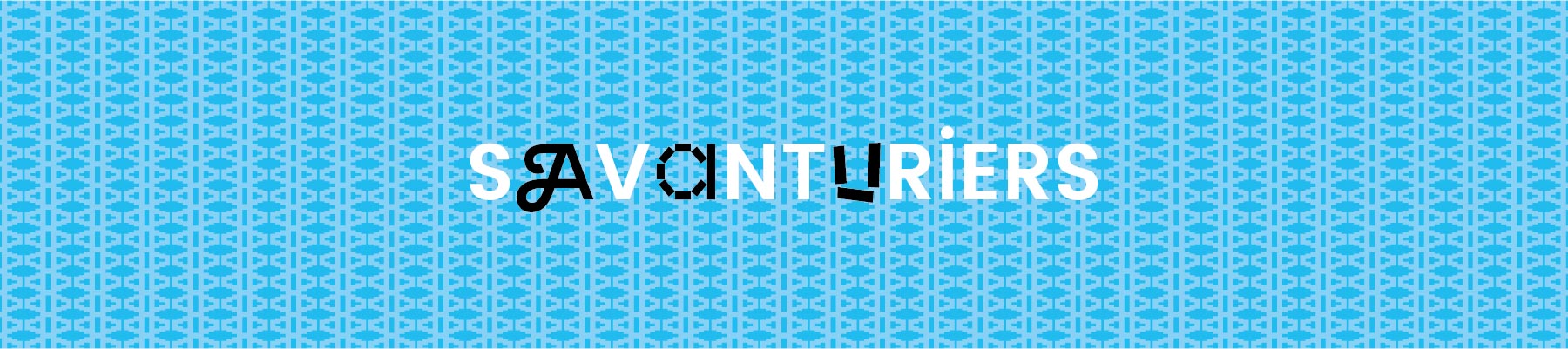
- >Recherche
- >Science et société
- >Parutions
- >La jeunesse n’est-elle qu’un mot ?
La jeunesse n’est-elle qu’un mot ?
Le 9 décembre 2025 de 16:30 à 17:30
Romain Robinet, David Niget, Yohann Le Moigne et Andrea Cabezas Vargas, enseignant∙es-chercheur∙es de l’UA, ont coordonné la publication de l’ouvrage De la jeunesse aux Amériques, qui sera présenté à la MRGT le 9 décembre. Ce dernier met en lumière les formes de politisation de la jeunesse, ainsi que ses dimensions culturelles et médiatiques, dans plusieurs pays du continent américain. Et répond à l’affirmation du sociologue Pierre Bourdieu : « La jeunesse n’est qu’un mot ».

Yohann Le Moigne, Romain Robinet et Andrea Cabezas Vargas ont coordonné la publication de l’ouvrage De la jeunesse aux Amériques.Porté par Romain Robinet, le programme de recherche Politisations juvéniles aux Amériques (XXe – XXIe siècles) a réuni plusieurs enseignant∙es-chercheur∙es des laboratoires Temos et 3L.AM de l’Université d’Angers. Les textes collectés lors d’une journée d’études et du colloque international en mars 2020 ont servi de base pour l’ouvrage De la jeunesse aux Amériques, publié en mai 2025, aux PUR. « L’étude de la politisation des jeunes demeure un terrain de recherche peu exploré, détaille Romain Robinet. Les travaux réunis dans ce livre permettent de donner chair à la jeunesse à partir du passé et du présent des Amériques. »
Du Chili au Québec, en passant par les États-Unis
La jeunesse est ici appréhendée comme une catégorie sociale construite qui englobe les jeunes issus des couches populaires, des classes moyennes et dominantes. Qu’ils soient noirs, blancs, métis ou indigènes, paysans ou étudiants, ces jeunes « sont un élément structurant du XXe siècle américain et ont contribué à la radicalité politique des années 1968, poursuit Romain Robinet. La variété et l’intensité des mobilisations juvéniles à cette période sont d’ailleurs le cœur de la première partie de l’ouvrage. »
L’occasion de se pencher sur la jeunesse démocrate-chrétienne chilienne des années 1960 (avec, en point d’orgue, la Marche de la jeune patrie), la mobilisation de collégien∙nes au Québec en 1968 dans un contexte de grève des enseignant∙es (un journal local publie à cette occasion un article intitulé « Quand des enfants irresponsables se mêlent d’une querelle d’adultes »), ou le soulèvement d’ouvriers argentins à l’usine en mai 1969, très vite rejoints par des étudiant∙es.
La seconde partie aborde, elle, les insubordinations juvéniles (refus d’obéissance, incivilités, critiques de l’autorité). David Niget y dépeint ainsi les logiques de politisation de la déviance juvénile féminine, un « phénomène » traversé par des rapports de genre mais aussi de classe sociale. « L’Amérique du Nord est considérée comme un lieu où se pose avec acuité des problèmes contemporains de la jeunesse autour des questions sociales, d’éducation, de santé publique, mais aussi autour de la notion de citoyenneté. Qu’il s’agisse de protéger la société d’une jeunesse menaçante ou de protéger les jeunes eux-mêmes, les mineurs de justice sont rarement perçus comme des sujets politiques. Je me suis intéressé à la Cour du bien-être social de Montréal, instance qui prend en charge les mineurs délinquants à partir de 1950. »
La dernière partie est consacrée à la jeunesse comme culture. De l’esthétique de la révolte dans le cinéma documentaire chilien des années 2000 à la transformation du rap aux États-Unis, la jeunesse « peut s’apparenter à un vaste incubateur de pratiques nouvelles, concluent les auteur∙es. Les jeunesses américaines, dans toute leur complexité et leurs vicissitudes, forment donc autre chose qu’un “mot”. »
Présentation du livre le 9 décembre
Dans le cadre des Cafés PUR, un temps de présentation de l’ouvrage collectif De la jeunesse aux Amériques. Politisations, altérités, cultures (XXe-XXIe siècles) est organisé le mardi 9 décembre 2025, de 16h30 à 17h30, dans la salle Frida Kahlo de la Maison de la recherche Germaine-Tillion (5 bis, boulevard de Lavoisier à Angers). Il sera animé par Paloma Segovia Becerril (doctorante à Temos) et Adrien Garcian.
En bref
De la jeunesse aux Amériques. Politisations, altérités, cultures (XXe-XXIe siècles), coordonné par Andrea Cabezas Vargas (3L.AM), Yohann Lemoigne (3L.AM), David Niget (Temos) et Romain Robinet (Temos), est paru en mai 2025 aux Presses universitaires de Rennes (PUR), avec le soutien de l'Université d'Angers.
252 pages
EAN : 9791041303359
Voir le livre sur le site de l'éditeur

