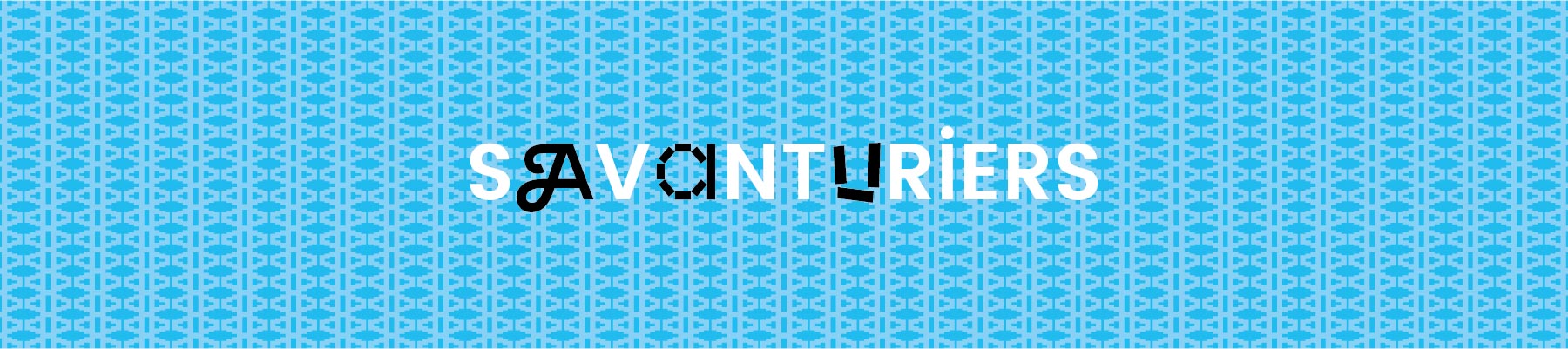
- >Recherche
- >Science et société
- >Parutions
- >«Être féministe, c’est une manière de vivre, pas seulement un combat »
«Être féministe, c’est une manière de vivre, pas seulement un combat »
Le 3 mars 2021 de 00:00 à
Christine Bard, historienne spécialisée de l’histoire des femmes, du féminisme, de l’antiféminisme et du genre, est également professeure d’histoire contemporaine à l’Université d’Angers et membre senior de l’Institut universitaire de France. Elle publie un nouveau livre intitulé Mon genre d’histoire. Entretien.
Pourquoi avoir écrit ce livre ?
Christine Bard : Ce livre est une commande des Presses universitaires de France (PUF) à l’occasion du centenaire de la maison d’édition. C’est un grand entretien réalisé avec Jean-Marie Durand, ancien rédacteur en chef des Inrockuptibles. Il était intéressé par mes prises de positions sur le féminisme puisque j’interviens effectivement dans le débat public en apportant des éclairages, souvent des mises en perspectives historiques. C’était un exercice intéressant, même si j’ai eu l’impression bizarre de me mettre à nu. J’espère que les lectrices et lecteurs vont apprécier ma sincérité et mes questionnements car j’ai pris plaisir à partager tout cela.
Quels sont les thèmes abordés dans ce livre ?
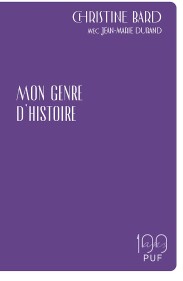
C.B : Une large partie du livre est consacrée à ce que signifie être historienne. C’est passionnant, tout comme réfléchir à l’origine de ma curiosité pour l’histoire du genre, même si ce n’est pas la première fois que je me pose la question. On rédige en effet une égo-histoire lorsque l’on soutient son habilitation à diriger des recherches (HDR). Je partage mon itinéraire de chercheuse, en rappelant qu’à l’époque de mes études, l’histoire des femmes était totalement absente des cours universitaires. J’ai eu ensuite la joie – une joie justicière - de participer à un grand chantier collectif de recherche qui a fait naître un nouveau domaine du savoir. J’ai soutenue en 1993 ma thèse sur « Les féminismes en France (1914-1940) » et bien sûr je rends femmage à Michelle Perrot, qui en fut la directrice. J’évoque également l’histoire du féminisme jusqu’à la « troisième vague » très intense que nous connaissons actuellement ; j’insiste sur l’antiféminisme, qui est avant tout un discours réactionnaire ; je m’intéresse aussi beaucoup au rapport entre le sexe, le genre, les vêtements et le corps. Pourquoi pensons-nous comme nous pensons ? C’est une question qui me taraude.
D’où vient alors notre manière de penser ?
C.B : Nous sommes marqué.es par notre milieu social, notre scolarité, nos études, notre famille, notre cercle amical, nos engagements associatifs, politiques, etc. C’est ce que j’esquisse dans ce livre, qui prend des allures d’auto-analyse. Je suis une fille du Nord de la petite classe moyenne et j’étais très proche de ma grand-mère Fernande, d’origine belge. Je l’observais s’habiller, se maquiller, je me souviens de ses conseils d’hygiène et d’élégance. Elle avait ouvert un magasin de chapeaux et je jouais, petite, avec les invendus qui prenaient la poussière dans le grenier. Sans cette proximité avec Fernande, je n’aurais jamais écrit mon livre sur Les Garçonnes (1998). Je suis également la première de ma famille à être allée à l’université. Être une transfuge de classe, comme le fait de changer de région, c’est faire un voyage social qui amène à se poser pas mal de questions. Et bien sûr, le féminisme : une cause qui me tient à cœur depuis plus de 35 ans désormais. Cet engagement est plus qu’un combat intellectuel, c’est une manière de vivre.
Ce sont des sujets de plus en plus traités dans les médias et l’espace public.
C.B : Je suis très sollicitée par les journalistes, quotidiennement. Le féminisme et, au-delà les questions de genre, sont désormais très présentes dans les médias. Nous vivons une révolution anthropologique avec la maitrise de la fécondité, la liberté sexuelle, les droits des personnes LGBT, c'est une nouvelle manière de conceptualiser le sexe et le genre. Il s‘agit d’une grande rupture dans l’histoire et c’est exaltant d’y participer. La recherche aussi s’y intéresse puisque l’Université d’Angers à l’instar du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) encourage ce type d’études. Autre exemple de cet engouement : le master « études sur le genre » reçoit des centaines de candidatures pour une trentaine de places. L’intérêt des 15-30 ans pour le féminisme est énorme.
Le mouvement #MeToo a également libéré la parole de nombreuses personnes…
C.B : De nombreuses victimes d’agressions sexuelles, notamment à travers #MeToo, s’expriment désormais publiquement. Elles dénoncent l’impunité des agresseurs et affrontent un véritable parcours du combattant lorsqu’elles portent plainte et peuvent redouter le non-lieu, très fréquent. Il est important d’aborder, à l’université, l’histoire du viol, longtemps considéré comme une fatalité. Aujourd’hui, la souffrance des victimes commence à être reconnue et on rêve d’un monde où cette violence n’existerait plus. Nous avons fait des pas de géante grâce à des lanceuses d’alerte remarquables, je pense par exemple à Muriel Salmona. Certes, les acquis sont fragiles, surtout en cette période de pandémie. Mais les luttes collectives sont efficaces et dans ce processus de transformation de la société, l’histoire, plus largement les sciences humaines et sociales, jouent leur rôle et nous rendent plus lucides sur les sociétés dans lesquelles nous vivons.
